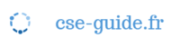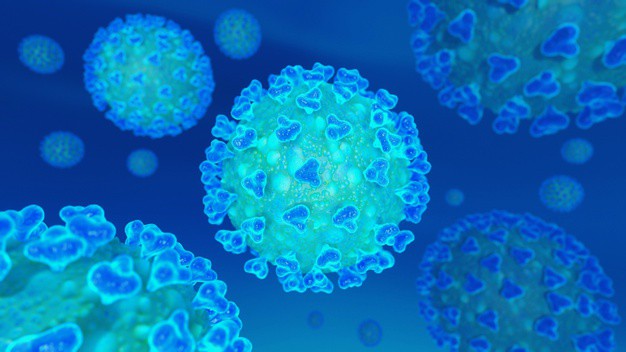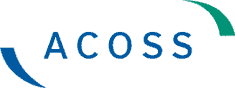Une véritable crise sanitaire, économique et sociale frappe l'ensemble du monde depuis le début de l'année 2020. Le coronavirus, du latin "corona" signifiant "virus à couronne", a été dénommé ainsi, car son étude au microscope démontre qu'il est rond tout en étant entouré de protubérances, comme une couronne ou un bouchon de bière. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la COVID-19 et les implications de la lutte contre l'épidémie pour le monde du travail, touchant les employeurs, les salariés ainsi que les élus, représentants du personnel.
Coronavirus et Covid-19 : qu'est-ce que c'est ?
Le coronavirus
Le coronavirus est un type de virus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de virus ayant pour effet d'entraîner des pathologies chez les mammifères et les oiseaux.
Sur le plan humain, les coronavirus viennent provoquer des infections des voies respiratoires généralement bénignes, comme un rhume, mais parfois plus graves comme le SRAS-CoV en 2002, le MERS-CoV en 2012, ou encore le SARS-CoV2, l'agent responsable de la maladie dénommée Covid-19 et ayant engendré depuis début 2020 une pandémie mondiale. La COVID-19 peut provoquer des infections gastro-intestinales et du système nerveux, des insuffisances pulmonaires ou cardiaques pouvant être mortelles.
La Covid-19
En janvier 2020, la Covid-19 a été décelée comme étant à l'origine de plusieurs cas groupés fin 2019 de pneumonies en Chine dans la ville de Wuhan sur un marché local où était vendu des animaux sauvages.
Ce n'est que le 7 février 2020 que des scientifiques de l'Université d'agriculture du sud de la Chine ont identifié le pangolin - petit mammifère menacé d'extinction très prisé dans la gastronomie chinoise et vietnamienne pour sa chaire délicate - comme intermédiaire soupçonné d'avoir transmis le coronavirus à l'homme.
Aujourd'hui, nous sommes passés d'une épidémie chinoise à une pandémie mondiale avec des chiffres alarmants, selon les chiffres de l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités locales :
- Du 1er février au 15 février 2020, le nombre de cas est passé de 11 959 à 67 094 ;
- Du 1er mars au 15 mars 2020, le nombre de cas est passé de 88 275 à 133 970.
Début avril 2021, le bilan mondial s'établit à plus de 130 millions de cas et plus de 2,8 millions de décès dans le monde entier. Si la mise en place, extrêmement rapide d'un vaccin depuis fin 2020 fait espérer une sortie de crise, la pandémie a engendré, dans le monde, en Europe et en France l'alternance de nombreuses période de confinement et de déconfinement, la fermeture et l'interdiction de nombreuses activités, un bouleversement des activités professionnelles et personnelle ainsi qu'une crise économique et sociale sans précédent.
De nombreuses recommandations pour limiter la propagation du virus ont été progressivement diffusées, à mesure que les études sur les conditions de contamination se développaient pour lutter contre la pandémie. Ces recommandations sont encore en évolutions régulières et doivent être suivies de près par les entreprises. De ce fait, il appartient à tous les élus de faire preuve de vigilance en prenant en compte ces recommandations et d'alerter les employeurs pour contribuer à assurer la santé des salariés tout en maintenant l'activité de l'entreprise.
Covid-19 : quels moyens d'action en entreprise ?
Quelles mesures préventives adopter au sein de l'entreprise ?
Afin d'éviter / limiter la propagation de la Covid-19, il faut adopter un certain nombre de mesures, conseillées ou obligatoires, recensées et régulièrement mises à jour par le ministère du Travail, dans un protocole national de santé et de sécurité des salariés. Ce protocole contient toutes les mesures à mettre en place et à communiquer auprès des salariés (mails et affiches du gouvernement dans l'entreprise). Parmi elle il y a d'abord le respect des gestes barrières, valables en entreprise, mais également dans la vie quotidienne :
- se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;
- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ;
- éviter de se toucher le visage ;
- respecter une distance d'au moins 2 mètres avec les autres ;
- se saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades ;
- porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 partout ou cela est désormais obligatoire et lorsque la distanciation de 2 metres ne peut pas être respectée ;
- limiter au maximum ses contacts sociaux ;
- aérer les pièces au maximum, au moins quelques minutes toutes les heures ;
- télécharger et utiliser les outils numériques mis à disposition par le gouvernement.
Comment agir si un salarié présente les symptômes d'une contamination ?
Élus, nous vous recommandons trois moyens d'action à partager avec l'employeur pour assurer la santé et la sécurité les salariés.
ACTION N°1 : La prévention
Le télétravail est considéré par le ministère du Travail comme le mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la limitation de la propagation de l'épidémie dans l'entreprise. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue élément de référence pour la mise en place de ce mode d'organisation du travail dans l'entreprise. Dans les périodes les plus graves de la pandémie le télétravail est considéré doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent et portée dans la mesure du possible à 100 %.
S'il s'avère qu'un salarié présente des signes d'infection respiratoire (fièvre, toux...), vous devez immédiatement contacter le SAMU en appelant le 15 en faisant état des symptômes et éviter qu'il entre en contact avec les autres salariés ou des clients.
D'un point de vue RH, il convient de faire un point sur le fonctionnement de chaque service et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Enfin un référent COVID doit être désigné au sein de l'entreprise (cela peut être le dirigeant lui-même). Le référent COVID "s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel."
ACTION N°2 : les règles de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail
En tant que garant de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale des salariés après évaluation du risque de contagion dans l'entreprise.
La Covid-19 se transmet par un contact étroit avec une personne déjà contaminée. Lorsque le travail en présentiel est nécessaire, des mesures d'hygiène et de distanciations sociales ont été prévues et adaptées pour les entreprises afin de réduire au maximum le risque en supprimant les conditions d'expositions. L'employeur doit procéder à tous les aménagements nécessaires au respect de ces règles et doit également s'assurer de communiquer régulièrement pour rappeler ces règles.
L’employeur doit également informer les salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et les inciter à l'utiliser pendant les horaires de travail.
Depuis le 1ᵉʳ septembre 2020 le port du masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 est obligatoire dans les entreprises qui constituent des lieux clos et partagés même lorsque la distanciation de 2 mètres peut être respectée. Des exceptions ont été précisées par le ministère du Travail dans un document de question/réponse.
ACTION N°3 : NETTOYER LES ESPACES DE TRAVAIL
Le Covid-19 peut survivre 3 heures sur des surfaces sèches et, dans ces conditions, il convient d'adopter des mesures strictes de nettoyage :
- un équipement spécifique aux personnes en charge du nettoyage avec des gants et blouses à usage unique
- un nettoyage des sols et surfaces avec un bandeau de nettoyage unique imprégné de détergeant
- un rinçage à l'aide d'un autre bandeau à usage unique
- une désinfection à l'aide d'un autre bandeau de nettoyage et de l'eau de javel diluée
Que faire si un salarié vous informe qu'il doit garder son enfant en raison de la fermeture de son établissement scolaire ?
Dans son allocution télévisée du 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture de toutes les crèches, écoles et universités afin de limiter la propagation du virus par les enfants. Cela s'est reproduit également en mars 2021. En dehors de ces périodes particulières les classes peuvent suivre un protocole assez stricte et être régulièrement fermée en cas de cas de COVID-19 au niveau de la classe ou même de l'école.
Élus, nous vous avons recensés trois actions pour gérer cette situation.
ACTION N°1 : RECOURIR AU TÉLÉTRAVAIL
Il convient de vérifier que les missions du salarié peuvent être réalisées en télétravail, puis de s'assurer que le salarié dispose d'un endroit adapté, à son domicile, pour réaliser son travail dans de bonnes conditions.
Enfin, s'interroger sur la mise en œuvre du télétravail au sein de l'entreprise par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur : s'il existe de tels documents, il faut suivre la procédure définie, si non, il est possible de recourir au télétravail par un accord écrit entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le Code du travail.
ACTION N°2 : MODIFIER LES DATES DES CONGÉS PAYES
Il faut impérativement vérifier les prochaines dates de congés des salariés : si elles sont déjà posées, il est possible de les déplacer et, si elles ne sont pas posées, il faut respecter la procédure habituelle de pose des congés payés.
ACTION N°3 : METTRE EN PLACE UN ARRÊT DE TRAVAIL
Dans cette situation, il convient d'établir une déclaration d'arrêt de travail par l'employeur sur le site www.ameli.fr à compter du jour de l'arrêt pour la durée de la fermeture de l'école.
Ensuite, il convient de savoir qu'un seul parent par enfant peut bénéficier de cet arrêt et doit fournir une attestation spécifique.
Enfin, il faut transmettre ces informations au service paie en précisant que cela concerne la procédure Covid-19 afin de supprimer les trois jours de carence des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Les confinements et déconfinements liés à l'épidémie
Le premier confinement de mars 2020
Le 12 mars 2020 dans son allocution télévisée le Président de la République a prononcé des annonces fortes à destination des entreprises. Il est notamment recommandé aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elle, mais également à tous les Français de limiter leurs déplacements au strict nécessaire et privilégier les réunions virtuelles et à l'employeur de privilégier le télétravail.
Le 14 mars 2020, le Premier ministre déclarait la fermeture de tout lieu non indispensable au public, à savoir les bars, restaurants, centres commerciaux, théâtre, musées, établissements sportifs couverts, salles de danse, bibliothèque pour limiter la propagation du virus. À ce titre, sont restés ouverts les magasins de vente (supermarché ou supérette) non situés dans les centres commerciaux, les pharmacies, les transports pour se rendre au travail et les stations essence.
L'ensemble des mesures prises par le gouvernement ont été détaillées au sein d'un arrêté paru le 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Ce confinement de la France, comme en Italie, a dû être pris en compte par les entreprises, qui ont dû réfléchir aux deux mesures pour assurer la continuité de leur activité :
- Le télétravail permettant aux salariés de travailler chez eux dans la mesure du possible et, dans ce cas, les entreprises doivent éventuellement se rapprocher de leur service informatique pour la mise à disposition du matériel nécessaire (ordinateur portable, transfert des appels sur téléphones portables...) ;
- Le chômage technique ou chômage partiel, où les salariés doivent être indemnisés par une indemnité versée par l'employeur, qui doit engager des démarches auprès de la DIRECCTE préalablement à la mise en place du dispositif afin de pouvoir en bénéficier et obtenir l'allocation de l'État correspondant aux heures dites chômées. À ce titre, le Président de a République, lors de son allocution télévisée du 12 mars 2020 a déclaré un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel, dont la prise en charge de l'indemnisation reviendra à l'État pour les salariés contraints à rester chez eux avec des conditions fixées prochainement. Ce mécanisme est toujours en vigueur pour les secteurs qui ne peuvent toujours par reprendre normalement leurs activités.
Face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures immédiates afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise :
- Des délais de paiements d'échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
- Des remises d'impôts directs dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;
- Un rééchelonnement des crédits bancaires à négocier avec le soutien de l'Etat et la Banque de France ;
- La mobilisation de Bpifrance afin de garantir des lignes de trésorerie bancaires pour les besoins des entreprises pendant le temps de l'épidémie ;
- La mise en place d'un dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé afin de maintenir l'emploi ;
- La mise en place d'un appui au traitement d'un conflit avec les clients ou les fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;
- La reconnaissance du coronavirus ou Covid-19 comme un cas de force majeure pour ses marchés publics entraînant la non-application des pénalités de retard.
Le déconfinement de mai 2020
Un déconfinement progressif a ensuite eu lieu le 11 mai 2020 en France pour relancer l'activité économique, qui s'est vue extrêmement réduite avec le confinement imposée depuis le 17 mars 2020 au regard de la grave crise sanitaire de la COVID-19 que le monde vit. Mais, comment s'est opéré ce déconfinement progressif ?
- Le maintien stricte des gestes barrières pour tous
Le déconfinement s'est assorti d'un renforcement des gestes barrières, qui se sont accrus avec une meilleure connaissance des conditions de propagation du virus. Il s'agit donc de différentes mesures à respecter pour limiter les risques de transmission du virus.
- Se laver régulièrement les mains pendant 20 à 30 secondes avec de l'eau, puis du savon et frottez bien le dessus et le dessous, ainsi que les ongles, les rincez, les séchez avec une serviette à usage unique.
- Éviter de toucher son visage.
- Désinfecter les objets manipulés, ainsi que les surfaces.
- Refuser tout serrage de main ou de faire la bise.
- Respecter une distance de 2 mètres à minimum entre chaque interlocuteur.
- Aérer 10 minutes toutes les heures.
- Rester chez soi en cas de symptômes (fièvre, fatigue, toux sèche, courbatures, perte du goût), contacter son médecin traitant ou le SAMU via le 15 si les symptômes sont graves (difficultés respiratoires).
- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable.
- Éviter le port des gants.
- Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 partout où c'est obligatoire.
- Des mesures spécifiques à l'entreprise
Comme évoqué précédemment, l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés tout en maintenant l'activité de l'entreprise. Il doit évaluer les risques professionnels encourus par son personnel en matière de santé dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Puis, dans un second temps, il doit rapporter ces risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
En pleine crise de COVID-19, le Tribunal Judiciaire de Nanterre est venu condamner l'entreprise AMAZON FRANCE dans sa décision du 14 avril 2020 au motif du non-respect par cette dernière de son obligation de sécurité et de prévention de la santé de ses salariés. L'entreprise interjette appel, mais la cour d'appel de Versailles confirme la décision, tout en nuançant / adoucissant la décision de première instance.
En l'espèce, le Tribunal a demandé à l'entreprise d'arrêter l'activité de ses entrepôts, car ces derniers rassemblaient plus de 100 personnes dans un même lieu clos, mais également d'arrêter la vente et la livraison de produits non-essentiels (c’est-à-dire qui ne soient ni alimentaires, ni d'hygiène, ni médicaux) afin de réduire le nombre de salariés présents sur les sites, et, enfin, procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de COVID-19.
Il convient donc de relever que les entreprises doivent tirer les leçons de la condamnation de l'entreprise AMAZON FRANCE au regard des moyens que l'entreprise doit mettre en œuvre pour limiter le risque de contamination et permettre une mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Ainsi, l'entreprise doit s'assurer de :
- Mettre en œuvre des procédures de suivi des cas d'infection avérés ou suspectés, ainsi que des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été en contact avec eux (échanges réguliers entre les équipes des différents services avec l'équipe sécurité, visionner les caméras de surveillance, etc) ;
- Associer les représentants du personnel à l'évaluation et/ou la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- Procéder à l'évaluation des risques psycho-sociaux dans ce même document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- Mettre à jour tous les plans de prévention et les protocoles de sécurité ;
- Privilégier les comptes-rendus écrits afin de prévenir tout audit en matière de mesures de prévention concernant la santé et la sécurité des salariés ;
- Mettre en place des formations adaptées à chaque poste de travail tout en veillant à en justifier par un écrit.
Outre ces mesures, l'employeur doit mettre en place les dispositifs suivants :
AMÉNAGER L'ESPACE
Organiser une rotation des travailleurs si le télétravail n'est pas possible (travailleurs du matin / travailleurs de l'après-midi), réaménager les espaces avec un minimum de 4m² par personne, prévoir un équipement de protection individuelle en masque et gel hydroalcoolique, organiser l'approvisionnement et l'évacuation.
GÉRER LES FLUX DES DIFFÉRENTS INTERLOCUTEURS
Identifier et prévenir les risques (processus de gestion des entrées et des sorties) et informer les salariés sur la création de plans de circulation pour permettre la distanciation sociale.
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé et le ministère de la Santé, la COVID-19 survit différemment selon les surfaces, soit de quelques minutes sur la peau, jusqu’à 12 heures sur les masques et les vêtements, jusqu’à 4 jours sur du bois, jusqu’à 5 jours sur du métal et du verre et jusqu’à 9 jours sur du plastique. Quel nettoyage adopter ?
Si les locaux n'ont pas été occupés les 10 jours précédents la fin du confinement, la désinfection complète des bureaux par nébulisation n'est pas obligatoire, mais un simple nettoyage reste important.
À l'inverse, si les locaux ont été occupés pendant les 10 jours précédant la fin du confinement, alors il convient d'opérer une décontamination complète des locaux afin de supprimer tout risque de présence du virus COVID-19, notamment par nébulisation, qui garantit l'élimination complète du virus dans les bureaux selon un protocole par pulvérisation d'un produit prenant la forme d'un brouillard, tel que le STERI-7.
DÉPISTAGE
Le dépistage par test est interdit, mais celui par contrôle de température est autorisé tout en étant déconseillé, c'est-à-dire que le salarié a droit de le refuser.
En complément des deux liens conseillés sur le site du ministère du Travail en début de ce dossier, vous pouvez télécharger gratuitement les fiches pratiques du ministère pour chaque métier en cliquant sur ce lien et consulter les différentes recommandations à adopter selon que votre zone soit verte ou rouge sur le site du gouvernement !
Exemples de questions posées par les salariés
- Je suis mis en télétravail et que je dois garder mes enfants. Je me rends compte de l’incompatibilité de travailler et de garder mes enfants. Puis-je bénéficier de l’arrêt maladie pour garde d’enfant ?
- garde d’enfant ? Mon conjoint est déjà en télétravail, mon employeur est dans l’impossibilité de me proposer télétravail, ais-je le droit de demander un arrêt pour garde d’enfant ?
- Ais je le droit à un arrêt pour garde d’enfant, si mon conjoint est placé en chômage partiel ?
- Puis-je prétendre à un arrêt pour garde d’enfant, lorsqu’il a plus de 16 ans?
- Je suis placé en chômage partiel. Ais-je toujours le droit de bénéficier de mon véhicule professionnel ?
- L’activité partielle peut-elle être déclarée postérieurement à la réelle mise au chômage partiel ?
- Mes cotisations retraite s’arrêtent elles pendant ma période d’activité partielle ?
- Elus du CSE : quelle rémunération pour les heures de délégation et l’activité partielle ?
- Comment sont rémunérés les salariés en forfait jours ? Sont-ils éligibles à l’activité partielle comme un salarié classique ?
- Un CSE peut-il financer, par le biais de son budget de fonctionnement, des aides exceptionnelles aux salariés en difficulté ?