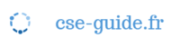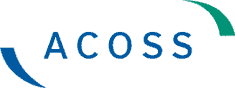La notion d’addiction au travail est apparue au début des années 70. Le Psychologue américain Wayne Oates invente le néologisme anglais “workaholic”, pour désigner cette nouvelle addiction : l’addiction au travail.
On parle indistinctement d’addiction au travail, de workaholisme ou encore d’ergomanie pour désigner cette notion contre intuitive : la dépendance psychologique au travail.
L’addiction au travail, comme bon nombre d’addictions comportementales est encore méconnue du grand public.
Pourtant, elle est bien réelle. Il n’existe pas d’étude suffisamment étayée, mais les psychologues estiment que 5 % de la population active en souffre.
Petit tour d’horizon de cette addiction qui cause de sérieux problèmes de santé à ceux qui en souffrent allant jusqu’au burn-out et même parfois la mort.
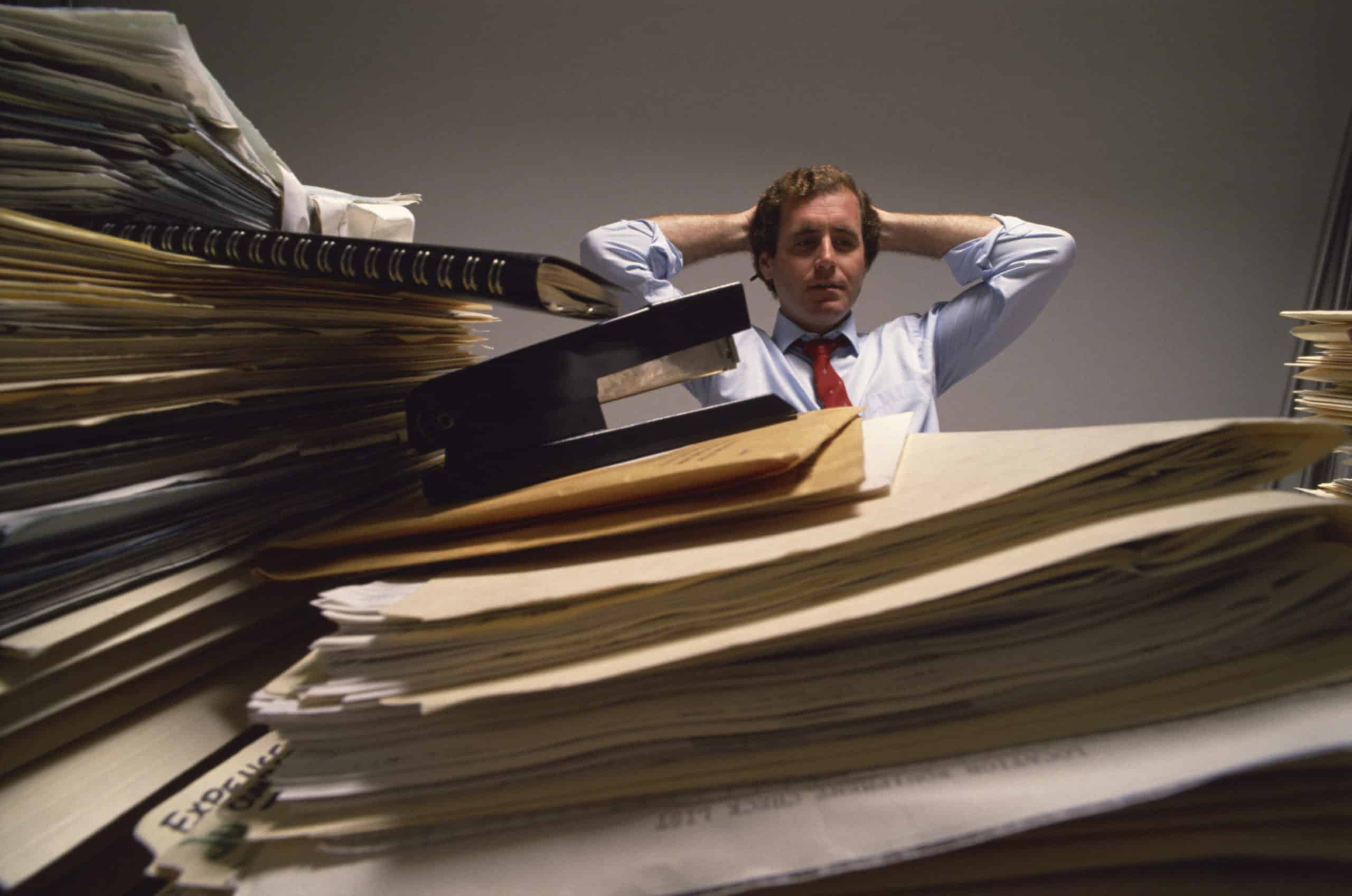
Qu’est-ce que l’addiction au travail ?
L’addiction au travail est une forme d'addiction comportementale (Addiction non pas à une substance, mais à un comportement) comme l’addiction au jeu, ou l’addiction sexuelle.
En 1992 deux psychologues américains Spence et Robbins ont étudié le phénomène de l’addiction au travail. L’étude les amena à déterminer trois critères cumulatifs pour la définition de l’addiction au travail.
Il s’agit de :
Pour Spence et Robbins, l’addict au travail est une personne qui a une implication et une tendance compulsive à travailler élevées, mais une satisfaction faible. C’est lui le vrai workaholic.
Les salariés qui présentent une implication dans leur travail et une tendance compulsive à travailler élevée ainsi qu’une satisfaction élevée sont qualifiés de workaholic “enthousiastes”.
Ils sont à surveiller, car il est possible qu’avec le temps, leur satisfaction diminue et qu’ils finissent dans la catégorie des workaholics non enthousiastes.
Comme dans les autres addictions comportementalesL’accro au travail ne travaille plus pour tel ou tel objectif. Il travaille de manière compulsive juste parce que s’il ne le fait pas il se sent anxieux et déprimé.
Il est important de savoir faire la différence entre un travailleur passionné, ou un travailleur investi, qui travaillent en vue d’un but et qui obtiennent une satisfaction dans l’exercice de leur travail et le travailleur compulsif qui ne maitrise plus son rapport au travail et fonce tête baissée jusqu’à l’épuisement.
Le développement des nouvelles technologies, facilite l’addiction au travail.
Distinction entre travailleur investi et accro au travail.
La distinction repose essentiellement sur la notion de satisfaction. Le travailleur compulsif n’est jamais satisfait.
Sa relation au travail est totalement disproportionnée par rapport aux objectifs professionnels. Il n’est jamais satisfait du travail accompli et cherche toujours à en faire plus.
Le travailleur investi, lui, travaille en repoussant fréquemment ses limites, parfois trop. Il reste cependant connecté avec ses objectifs et éprouve la satisfaction du travail qu’il a accompli. Il peut profiter de ses week-end et de ses loisirs, ce que ne peut plus faire le workaholic.
Il y a chez le travailleur compulsif une réelle relation d’addiction comme d’autres personnes peuvent l’avoir avec l’acool, la drogue, le sexe ou le jeu. Il n’y a plus de satisfaction, mais uniquement une action compulsive pour éviter un sentiment de mal être. Le simple travailleur excessif pour sa part, travaille certes avec excès, mais sans avoir perdu le lien avec ses objectifs. Que ce soit une motivation financière, ou d’égo.
Actuellement l’addiction au travail n’est pas reconnue par les classifications diagnostiques officielles (telles que le DSM-5 ou le CIM-11).
Comment détecter un salarié accro au travail ?
Pour pouvoir repérer efficacement les travailleurs compulsifs, il faut garder à l’esprit la définition de l’addiction au travail et les éléments de distinction entre le travailleur investi et le travailleur accro. Il s’agit principalement de la satisfaction ressentie dans le travail.
Dans les addictions comportementales le sujet est fréquemment dans le déni, son comportement compulsif est souvent un moyen de fuir un mal être ou une anxiété.
Il est donc particulièrement important que l’entreprise soit active dans la prévention la détection des cas d’ergomanie.
La liste (non exhaustive) ci-dessous donne un aperçu des comportements qui doivent attirer l’attention.
Quels sont les risques de l'addiction au travail pour les salariés ?
Le salarié qui souffre d’addiction à son travail encourt des risques sociaux, psychologiques et physiques.
Sur le plan social, le workaholic risque l’isolement. Privilégiant son travail aux autres aspects de sa vie, il néglige ses relations sociales et familiales qui par conséquent se détériorent. De plus le salarié accro à son travail a souvent de mauvaises relations avec ses collègues et collaborateurs. iI n’est pas sur le même rythme que les autres, il peine à déléguer et veut faire tout lui-même;
L’accroissement de tension nerveuse peut le rendre agressif, ce qui aggrave son isolement.
Sur le plan psychologique, le principal risque est le burn-out (ou syndrôme d’épuisement professionnel). Cela commence par un épuisement émotionnel dû à l’hyperactivité de l’addict qui dégénère en burn-out.
Sur le plan physique, le salarié addict s’expose aux risques causés par l’excès de stress doublé du manque de repos. Ces risques sont variés allant des ulcères, aux reflux gastriques en passant par le surpoids et les pathologies cardiovasculaires. De plus en raison de son addiction le workaholic néglige bien souvent la prise en charge de sa santé et s’expose à des diagnostics tardifs de pathologie évolutive.
Une étude de 2012 trouve chez les travailleurs compulsifs de plus forts niveaux d’anxiété, d’insomnie, de dysfonctionnement social et de dépression. Lire l'étude ici
Poussée à l’extrême, la dépendance au travail peut amener à la mort. C’est ce que les Japonais appellent le “karoshi” (littéralement “mort par dépassement du travail”).
Comment faire un état des lieux de la dépendance au travail en tant qu’élu CSE ?
La première chose à faire est de rester vigilant, et de repérer les salariés qui manifestent les signes indices d’une addiction au travail vus plus haut dans cet article.
Communiquez au sein de l’entreprise afin que les collègues puissent s’aider entre eux lorsqu’ils repèrent des signes d’addiction et de surmenage.
L’addiction d’un salarié à son travail est néfaste pour lui-même mais également pour ses proches collaborateurs et à terme pour l’ensemble des performances de l’entreprise. Il est donc de l’intérêt de tous, que chacun sache se ménager.
Vous pouvez vous aider des tests relatifs à l’addiction au travail que l’on a vus plus haut :
- Le Test WART
- Le test BWAS
- Le test workaholism battery
Enfin le médecin du travail vous sera d’une grande aide pour toute question liée au diagnostic ou au traitement de l’addiction d’un collaborateur à son travail.

Quelles solutions contre l’addiction au travail ?
Comment prévenir le workaholisme au sein de l’entreprise ?
La prévention du workaholisme s’articule principalement autour de deux principes : la prévention des risques psychosociaux et l’encadrement de l’utilisation des outils numériques.
Prenez des initiatives pour faire connaître les risques psychosociaux (RPS) et leurs incidences à l’ensemble des salariés de l’entreprise, afin que chacun puisse se surveiller soi-même et aussi les autres. Si besoin, faites intervenir un consultant sur la question de la Qualité de vie au travail et des RPS.
Par ailleurs, l’addiction au travail étant largement favorisée par les outils numériques les élus du CSE peuvent proposer à la direction une réflexion conjointe sur l’encadrement de l’utilisation de ces outils. Les outils numériques utilisés sans mesure amènent à l’effondrement de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans certaines entreprises, l’accès à la messagerie professionnelle est par exemple coupé à partir d’une certaine heure. Parfois il est simplement interdit d’envoyer un mail à partir d’une certaine heure.
Outre les outils numériques il est également possible de prendre des mesures physiques pour prévenir le workaholisme, par exemple la fermeture des bureaux à une heure précise.
Donner aux managers les outils pour lutter contre l’addiction au travail
Les Managers sont l’intermédiaire entre le terrain et la direction de la société. Ils occupent donc une position-clé pour la détection des 1er symptômes de workaholisme. Par les responsabilités du poste qu’ils occupent, ils sont également plus à risque.
C’est pourquoi la formation des managers en ce qui concerne les risques psychosociaux et particulièrement l’addiction au travail est stratégique. Encore plus au manager qu’au reste des employés il faut donner les connaissances nécessaires pour faire la différence entre un travailleur acharné (qui garde le contrôle) et un addict qui tend vers le burn-out.
Les managers, parce qu’ils sont des figures d’autorité, sont les vecteurs de la culture d’entreprise. C’est à eux de bien affirmer qu’il est important pour les salariés de se ménager. Plutôt que de valoriser le bourreau de travail à l’ancienne, mieux vaut mettre en avant l’image positive du salarié épanoui qui maitrise l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Faire remonter les cas inquiétants au service RH
Il est important de bien faire circuler les informations concernant ce type de risque professionnel à l’intérieur de l’entreprise.
En premier le service RH doit être averti des cas inquiétants afin de pouvoir mettre en place les solutions adaptées (entretien avec les salariés à risque, mise en action de la médecine du travail, etc.)
Le traitement de l’addiction au travail
Le traitement du workaholisme est souvent tardif en raison du déni des sujets atteints et du fait que cette affection est encore mal connue.
Dès les premiers soupçons d’addiction au travail relevés chez un salarié, il n’y a pas de temps à perdre, il faut demander une consultation du médecin du travail. Ce dernier pourra poser un diagnostic. Comme souvent plus le problème est pris tôt plus son traitement sera efficace et rapide.
Les thérapies comportementales et cognitives donnent de bons résultats. Il s’agit de thérapies qui présentent l’avantage d’être brèves. Au cours de la thérapie, le patient va être amené à modifier petit à petit son comportement en vue d’ un meilleur équilibre.
En parallèle le salarié accro pourra apprendre avec son thérapeute des techniques de relaxation lui permettant d’affronter dans les meilleures conditions possibles ces changements de comportement.
Il existe également des groupes de parole de “workaholic” dans lesquels les addicts peuvent obtenir du soutien.
L’addiction au travail cache souvent un problème plus profond que le salarié pourra creuser plus calmement lorsqu’il aura retrouvé un équilibre de vie.
En tant que membre du CSE votre mission se résume essentiellement à faire reconnaître son problème à votre collègue addict et à lui faire accepter de l’aide.